La première visite de Carl Rogers en France a eu lieu en 1966. Cet évènement était organisé par l’ARIP (Max Pagès, André de Peretti, André Lévy, Guy Palmade…). Après le séminaire de Dourdan, Rogers a participé à un colloque à Paris au cours duquel il a été accueilli très froidement par l’intelligentsia psychanalytique et fortement critiqué.
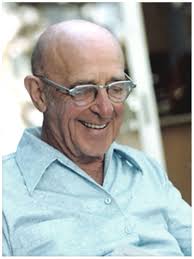
Carl Rogers en France : sa première visite en 1966
Dourdan et Paris
Un accueil mitigé
Contexte
En 1966, l’ARIP (Association pour la Recherche et l’Intervention Psychosociologique) prend la décision d’inviter Carl Rogers en France. Parmi les membres du comité organisateur, notons les noms de : Max Pagès, André de Peretti, André Lévy, Jean Dubost, Guy Palmade, Jean-Claude Filloux, Rouchy… Il y eut d’abord un séminaire expérientiel d’une semaine à Dourdan sous la forme classique du workshop rogerien (grand groupe de rencontre, sous-groupes…) qui a été suivi d’un colloque à Paris sous une forme plus classique avec une conférence de Carl Rogers. Puis Rogers a fait cette même conférence à Louvain en Belgique et aux Pays-Bas.
L’expérience a été mitigée. Rogers n’a pas été bien accueilli par le public français. Dans un long courrier adressé à l’ARIP en date du 15 mai 1966, il écrit : « J’ai trouvé incroyable la différence entre les Français d’une part, et d’autre part les Belges et les Hollandais. J’ai fait à Louvain exactement le même exposé que celui que j’avais fait le premier jour à Dourdan et le premier jour à Paris. Dans les deux derniers lieux, il a été accueilli très froidement et d’un oeuil critique. A Louvain, les applaudissements ont été si vifs et si longs que j’ai été réellement embarrassé. J’ai vécu le même type d’expérience en Hollande. Il m’a semblé que, contrairement aux Français, ils n’ont pas peur des sentiments personnels, des sentiments chaleureux, de l’intimité avec l’autre ». Et de regretter amèrement de n’avoir pu « être en contact réel et personnel » avec la plupart des membres de l’ARIP dont certains, il faut le mentionner, étaient fortement imprégnées de la pensée psychanalytique. Après avoir présenté le film de son entretien avec Gloria (voir la transcription de cet entretien sur cette même bibliothèque digitale), il a reçu une pluie de critiques, notamment au sujet du maniement de son contre-transfert, de son innocence, etc.
Voici le récit qu’en fait Annick Ohayon, historienne de la psychologie et de la psychanalyse, dans son livre : Histoire de la psychologie clinique en France. Fondements et premières esquisses. Colloque ”Actualité de la psychologie clinique. Une histoire en devenir”, nov 2014, Villetaneuse, Paris, France.
C.H.
***
APRÈS DOURDAN, CARL ROGERS EST CHAHUTÉ À PARIS
En 1958, Max Pagès et Guy Palmade ont fondé l’ARIP (Association pour la Recherche et l’Intervention Psychosociologique). Max Pagès est resté en relation épistolaire avec Rogers et, en 1966, l’invite à venir à Paris au nom de l’ARIP. Le psychologue américain et son épouse arrivent dans la capitale en avril 1966. C’est un événement culturel et scientifique important. On en trouve des compte-rendus dans Le Monde, dans Combat, dans Les Études et La Quinzaine Littéraire.
La rencontre se déroule en deux temps : Un séminaire résidentiel de Dourdan, qui dure huit jours et auquel participent quelque cent dix personnes. “Malgré leur prix élevé, les places disponibles furent rapidement enlevées”, note Georges Quintard qui en fait le compte-rendu dans le Bulletin de Psychologie. Plusieurs groupes (qu’on appelle alors T.Groups, c’est-à-dire Training Groups) fonctionnent en parallèle, et Rogers fait des conférences plénières. En dépit de tensions perceptibles au sein du staff d’organisation de l’ARIP, le séminaire se passe plutôt bien.
Puis se tiennent les conférences de Paris qui réunissent 412 personnes, pendant trois jours, et où se manifeste, selon les termes de Max Pagès, “un clivage total”. Le public est composé de professionnels du monde “psy” : psychologues, psychiatres, conseillers d’orientation, mais aussi de philosophes, de pédagogues, de journalistes, c’est-à-dire de ce qu’on peut nommer l’intelligentsia parisienne (J.-F. Lyotard, Gilles Deleuze, Paul Ricœur, François Roustang…). Ceux-là, selon Pagès, pour des raisons qui tenaient à leurs engagements dans le marxisme et dans la psychanalyse, ou les deux, furent totalement choqués. “C’est ça Rogers ? Mais qu’est-ce que c’est que ce type ? Il ne connaît pas les classes sociales, il ne connaît pas le transfert !”
L’un des moments les plus conflictuels suivit la projection d’un film qui était l’enregistrement intégral d’un entretien de Rogers avec une patiente, Gloria. Il y eut une longue polémique sur l’intérêt et la valeur des enregistrements d’entretiens thérapeutiques qui laissa Rogers pantois. En effet, il pratiquait cela depuis 1944, et c’était un instrument de contrôle, de perfectionnement et d’évaluation des thérapies très courant aux États-Unis. Mais ce qui scandalisa le plus fut son maniement — ou plutôt son déni — du transfert. Gloria lui déclare : “Mince, j’aurais aimé vous avoir pour père, je ne sais même pas pourquoi cela m’est venu à l’esprit”, et Rogers répond tout bonnement : “Je vous trouve une bien gentille fille (daughter), mais vous regretterez vraiment de ne pas avoir eu la possibilité de causer vraiment avec votre papa”.
Toute la gent psychanalytique se dressa, horrifiée. Jean Clavreul, alors secrétaire de l’École Freudienne de Paris, reprocha au psychologue américain de faire bon marché des conflits de l’inconscient, du refoulement de la libido, de l’instinct de mort, de l’histoire, du social, et de faire des pathologies mentales la pure et simple conséquence d’un milieu déviant et malsain. Rogers rétorqua qu’il connaissait bien la psychanalyse, qu’il avait même collaboré avec des psychanalystes et qu’il la considérait comme un système d’explication parmi d’autres, mais qu’aux États-Unis les tenants du freudisme étaient devenus “la secte la plus dure et la plus autoritaire”.
Bref, il n’y eut pas de vrai débat, mais un dialogue de sourds, Rogers se contenta de souhaiter que tous les thérapeutes se rencontrent pour confronter leurs réussites et leurs échecs et tenter de mettre en évidence les “lois simples !” (là encore, réaction ironique des cliniciens) qui les expliquent. L’accord se révéla meilleur avec les pédagogues (Philippe Meirieu, René Haby). Un lien s’opèrera d’ailleurs rapidement entre les méthodes de l’Éducation Nouvelle et l’orientation 14 non-directive en pédagogie, malgré les critiques virulentes des psychopédagogues marxistes, tel Georges Snyders.
Mais c’est l’échange avec les organisateurs qui fut finalement le plus violent. Guy Palmade soutenait qu’il ne pouvait y avoir de thérapie sans technique, qu’il n’y avait pas de raisons de la minimiser, que l’amour ne suffisait pas. Et Rogers, pointant son doigt sur la poitrine de Palmade s’exclama “Et moi, je veux savoir ce qu’il y a là !” Quant à Max Pagès, il était déchiré.
Pour lire l’entretien de Rogers avec Gloria, cliquer ici

